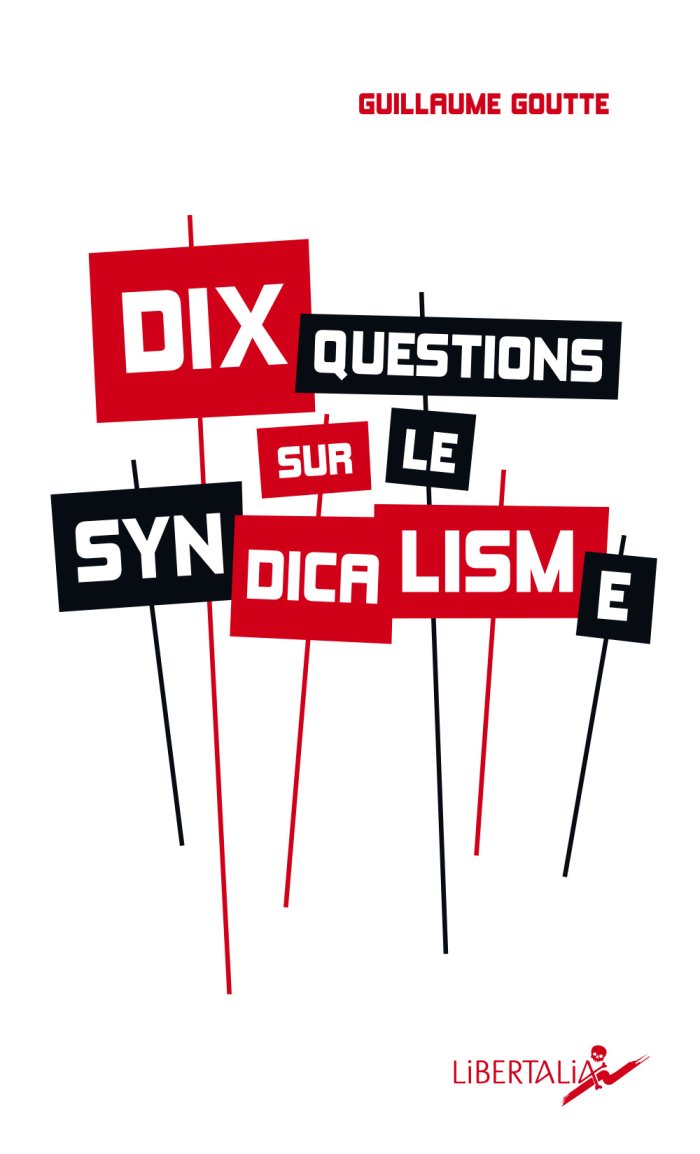En voilà un livre d’actualité ! Il paraît alors qu’Emmanuel Macron s’évertue à redynamiser des organisations syndicales que l’on pensait quelque peu endormies… Point n’est besoin ici de rappeler combien leurs appels à contester certaine réforme ont mobilisé – et mobiliseront encore, si l’on en croit les propos des manifestant·e·s rapportés par les médias (sans parler des grévistes de secteurs divers et variés). On aura peut-être moins remarqué ceux de ces militants syndicaux qui témoignent d’une vague d’adhésion comme ils n’en avaient plus vu depuis longtemps. On peut se montrer quelque peu sceptique quant au potentiel révolutionnaire des syndicats (j’avoue que c’est mon cas). Mais on aurait tort de les mépriser (à l’instar du monarque républicain suscité). C’est pourquoi je recommande la lecture de cet abrégé du syndicalisme.
Son auteur, Guillaume Goutte, se présente comme « militant syndicaliste, adhérent de la Confédération générale du travail (CGT), actif et en responsabilité au sein du Syndicat général du Livre et de la communication écrite ». Un peu plus loin, il ajoute : « Le livre part du postulat que le syndicalisme est non seulement nécessaire, mais qu’il doit aussi être indépendant et se donner les moyens d’incarner une pratique autonome de la lutte de classe. »
10 Questions, donc, et tout autant d’enjeux fondamentaux pour les organisations et pratiques syndicales.
1. Quand et comment le syndicalisme s’est-il formé en France ? On pourrait se dire que cela n’a guère d’importance et que ce qui nous intéresse, ce sont les rapports de forces actuels. Certes. Il se trouve cependant que les débuts du syndicalisme ont influencé son développement jusqu’à aujourd’hui – ainsi, par exemple, le clivage entre syndicalisme révolutionnaire et syndicalisme réformiste (pour faire simple, rapporté à aujourd’hui : CGT vs. CFDT). La préhistoire des syndicats commence pendant la Révolution française : sous prétexte d’empêcher la reconstitution des « corporations » de l’Ancien Régime, les lois Le Chapelier, votées par l’Assemblée constituante en mai et juin 1791, interdisent les « coalitions de métier » et les grèves. Comme disait Marx, il s’agissait de délivrer les prolétaires de tout lien contraignant les empêchant de vendre « librement » leur force de travail sur le marché tout aussi « libre » du travail… Ces dispositions seront encore aggravées par les Codes civil et pénal napoléoniens. Les…
La suite est à lire sur: lundi.am
Auteur: dev