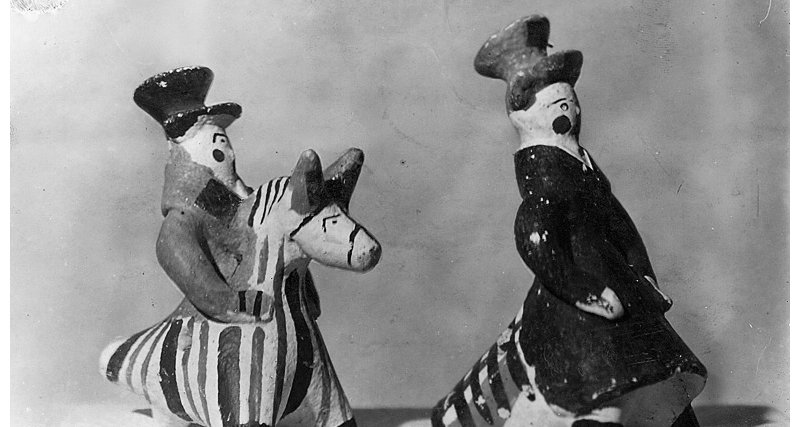Voici quelques notes (extraites d’un travail en cours) à propos des errances malheureuses de Walter Benjamin à Moscou lors de l’hiver 1926-1927.
Au cœur de ce travail il y a un nœud, syntaxique et nerveux, qui tente maladivement de retenir la lumière qui s’est couchée, un jour, sur le corps d’un amour. Que ce corps mort ait pu correspondre au corps de l’histoire, qu’une espérance d’amour ait pu se confondre à ce point avec l’espérance d’une révolution prolétarienne, c’est cela qui nous importe, et non que cet amour et cette révolution soient parvenus à un point d’achèvement, heureux ou détestable.
Ce qui n’a pas eu lieu n’est pas moins décisif que ce qui a eu lieu. En tant que vestige d’une forme possible, perdue, irrécupérable, l’amour de Benjamin et de Lācis ne cesse de nous concerner, de motiver nos recherches, de nous convaincre d’accumuler toujours plus de matériaux et de nous servir de l’écriture afin de leur offrir un lieu d’exposition, livrés ainsi à la possibilité d’un langage, étrange et neuf, comme le jour se levant sur les meurtrissures de l’histoire, petite ou grande, de celle qui fut, de celle qui vient, et de la nôtre surtout, au coeur de la catastrophe en cours dont nous sommes intégralement responsables.
En son temps, Benjamin a pressenti la catastrophe, ce qui ne l’a jamais empêché d’agir et de penser, d’hésiter, à entrer au KPD par exemple, quitte à sacrifier sa liberté d’intellectuel bourgeois. Entendons bien ce que cela peut signifier : être certain que la catastrophe est inévitable, ou qu’elle est déjà en cours, et s’obstiner pourtant à produire des textes, chercher à occuper une position stratégique au sein de la production culturelle et artistique de son temps, cela non afin d’en atténuer les conséquences, mais pour en léguer les virtualités.
À bon droit, commençons donc par la fin. Par la défaite de l’amour.
Au terme de…
Auteur: dev