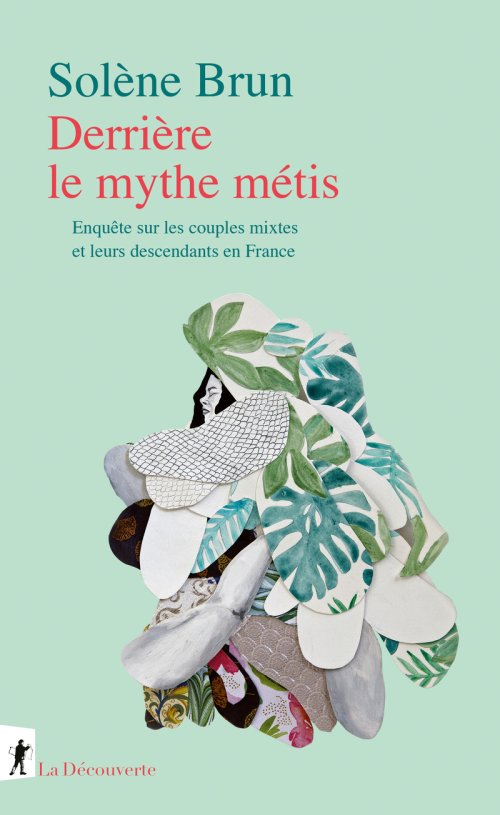Premier extrait : Introduction
Parce qu’elle est obligatoire et qu’elle n’implique aucun coût, contrairement à d’autres éléments des transmissions culturelles au sein des familles [1], la prénomination des enfants est une pratique sociale particulièrement intéressante pour étudier les goûts et préférences des parents, ainsi que leur rapport aux transmissions familiales et culturelles [2]. Investi du pouvoir de « signifier l’appartenance », le prénom représente un « élément particulièrement visible et permanent de l’identité de l’individu » [3]. En cela, il se révèle être un enjeu particulier de transmission symbolique et un marqueur identitaire important.
Le prénom est digne d’intérêt pour la sociologie en ce qu’il classe à la fois celui qui nomme et celui qui est nommé. Si le modèle classique de la prénomination consistait à relier l’individu nommé à sa parentèle élargie via le choix du prénom parmi les ascendants ou les parrains et marraines [4], le vingtième siècle a vu à la fois une dispersion des prénoms et un élargissement des références, les effets de mode et les enjeux de distinction prenant davantage d’ampleur [5]. En outre, les phénomènes d’immigration ont apporté de nouveaux stocks de prénoms.
Dans cette perspective, le prénom donne une indication sur l’appartenance au groupe de parenté, mais signale également un contenu culturel – de genre, de classe, d’origine nationale et/ou de religion. Pour les parents en couple mixte, ces différents enjeux se manifestent sous un jour particulier, la mixité intrafamiliale impliquant des appartenances multiples, à la fois eu égard aux origines nationales, mais également aux positions dans l’ordre social racialisé.
Les personnes rencontrées ont adopté plusieurs stratégies dans leurs choix onomastiques [6]. Parmi les trente-huit enfants des parents enquêtés, neuf ont reçu un prénom français comme…
La suite est à lire sur: lmsi.net
Auteur: Solène Brun