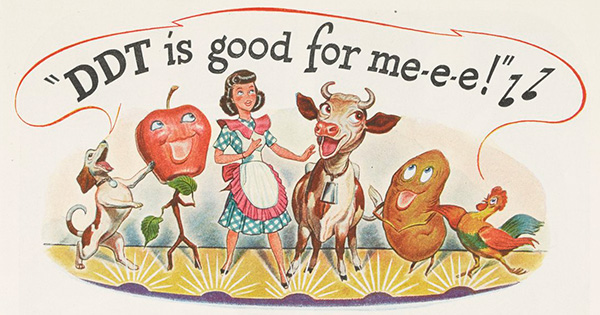John William Waterhouse. — « Circe Invidiosa » (Circé jalouse), 1892.
À l’orée des années 1960, on n’en parle pas encore. La nature c’est la pêche pendant les vacances, les nichoirs pour les oiseaux, les herbiers en classe de sciences naturelles. Des naturalistes formés par les réseaux d’éducation populaire vont créer les premiers groupes, dotés de bulletins ronéotypés, au sein d’une mouvance qui verra émerger La Vie Claire, Anper-Tos, la Sepanso et les centaines d’associations locales qui se fédéreront ensuite au sein de France nature environnement ou de la Ligue protectrice des oiseaux (LPO).
Lire aussi « Environnement : soixante ans de prise de conscience », Le Monde diplomatique, juin 2022.
À la maison on lit aussi Rustica, Nature et progrès ou Le Chasseur français. À la fin des années 1970, les parents amoureux de le nature abonnent leurs enfants, puis leurs petits enfants, à La Hulotte, qui vient de fêter ses cinquante ans. La presse écrite domine le paysage de l’information, même si les documentaires animaliers font leur trou à la télévision, que l’on regarde encore en famille. Presse nationale, spécialisée, quotidiens locaux donnent le « la ». Quelques grandes plumes se passionnent déjà pour l’environnement, à l’instar de Marc-Ambroise Rendu dans Le Monde, qui se battra trente-cinq ans durant, avec succès, pour la « réouverture » de la Bièvre à Paris.
La « grande presse » a encore les moyens de former des « rubricards » qui deviennent des spécialistes reconnus d’un sujet, parfois durant toute leur carrière, écrivant des livres, animant des débats, à mesure que la question de l’environnement investit le champ politique, comme en atteste le premier « ministère de l’impossible », confié par George Pompidou à Robert Poujade en 1971. La défense de la nature ce sont alors le commandant Cousteau, Alain Bombard,…
La suite est à lire sur: blog.mondediplo.net
Auteur: Marc Laimé