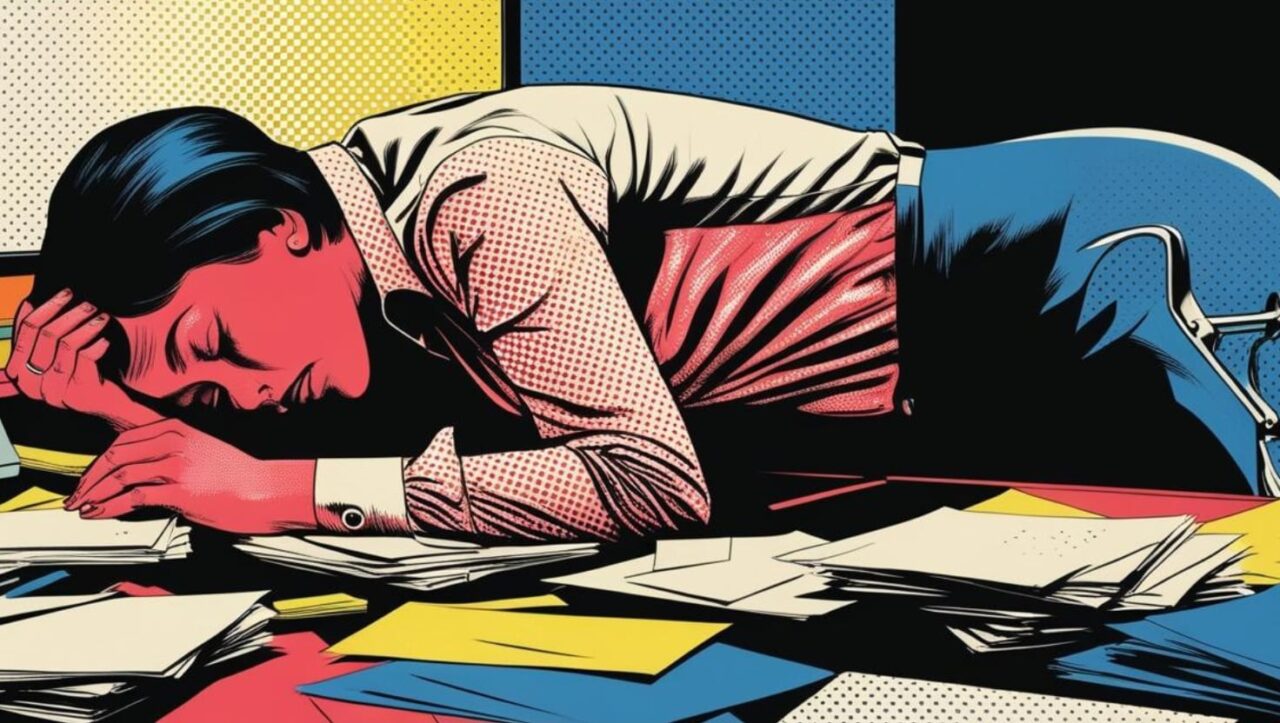En France, les dispositifs d’aide sociale sont de plus en plus marqués par une logique de suspicion et de surveillance. Loin d’être conçus comme des droits garantis, ils sont conditionnés à une série d’obligations bureaucratiques qui placent les bénéficiaires dans une position de dépendance et de précarité administrative. Cet encadrement tatillon et répressif reflète une vision paternaliste où l’État considère les allocataires non comme des citoyens autonomes, mais comme des individus à surveiller et à discipliner. Paradoxalement, ce traitement contraste avec l’indulgence dont bénéficient les entreprises et les contribuables aisés, pour qui les aides et allègements fiscaux sont octroyés sans contrôle excessif.
Des bénéficiaires coupables jusqu’à preuve du contraire
Les dispositifs sociaux, censés être des droits inconditionnels pour les plus précaires, fonctionnent sur une présomption de fraude qui transforme chaque bénéficiaire en suspect potentiel. Être pauvre, c’est d’abord prouver qu’on ne l’a pas fait exprès. Par exemple, la Cour des comptes signalait que les contrôles des allocations sociales avaient été intensifiés. Les fraudes sociales atteignaient 351 millions d’euros en 2022, ne représentant qu’une part infime des dépenses sociales : environ 1 à 3 % des prestations versées, bien loin des 80 milliards d’euros d’évasion fiscale annuels.
Être pauvre, c’est d’abord prouver qu’on ne l’a pas fait exprès
À France Travail (anciennement Pôle emploi), la logique de contrôle et de sanction s’est intensifiée ces dernières années, aboutissant à une explosion des radiations administratives. Dans la novlangue de France Travail, ‘accompagnement’ signifie : dégage et ne reviens pas. Selon une enquête de Mediapart, près de 500 000 demandeurs d’emploi sont contrôlés voire radiés (plus de 58 000 pour le seul mois de novembre 2022) chaque année, soit…
Auteur: Farton Bink