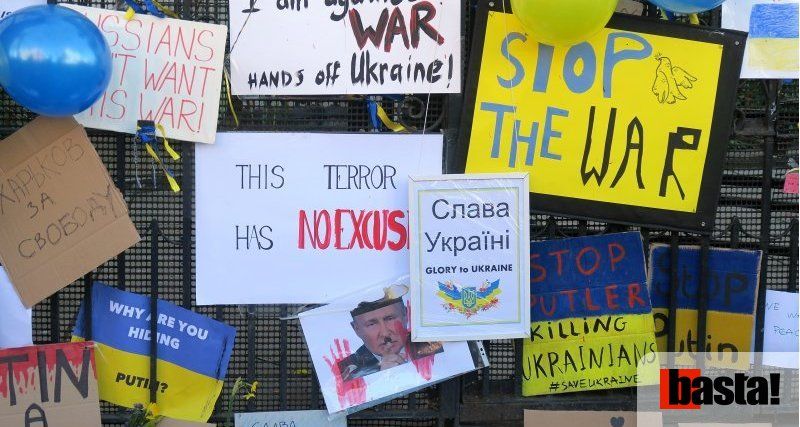Georgui a 28 ans, bien qu’il en paraisse moins. Il sourit gentiment et parle un français hésitant, mais efficace. Je le rencontre avec son partenaire Sergueï (30 ans) une après-midi d’avril. Ils sont arrivés en France avec l’aide de Russie-Libertés, une des associations qui soutient l’opposition russe, à l’instar de l’organisation allemande inTransit.
Georgui est premier lieutenant de l’armée russe, qu’il rejoint en 2017. Après avoir obtenu son diplôme à l’Institut de physique et technologie de Moscou, on l’invite à intégrer les forces armées pour son service militaire. Là-bas, il peut mettre en pratique les compétences en programmation acquises pendant ses études.
Il reçoit l’aval de sa famille : cette opportunité pourrait marquer le début d’une carrière militaire – une situation et un salaire avantageux. De plus, travailler pour la section informatique va de pair avec certains bénéfices : un poste de bureau, pas d’opérations sur le terrain et pas de manipulation d’armes, par exemple.
Impossible de quitter l’armée
L’année suivante, on lui propose, à la fin de son service, un contrat de cinq ans avec la promesse qu’« aucune de ses responsabilités ne changera ». Cependant, peu de temps après la signature, on l’informe que le poste pour lequel il a été recruté n’existe plus et qu’on l’enverra ailleurs. Bien entendu, impossible de mettre un terme prématurément à son engagement.
À partir de là, les conflits avec ses supérieurs commencent, même sur des sujets sans importance. L’orientation sexuelle de Georgui n’arrange rien, le stigma autour de l’homosexualité étant très fort dans un pays ou l’homophobie fait figure de politique d’État. La première loi visant la « propagande LGBT+ » date de 2013 et le gouvernement l’a renforcée en 2022, avec de graves conséquences sur les militants et les associations qui défendent les droits des personnes LGBTQIA+. « À…
Auteur: Francesca Barca