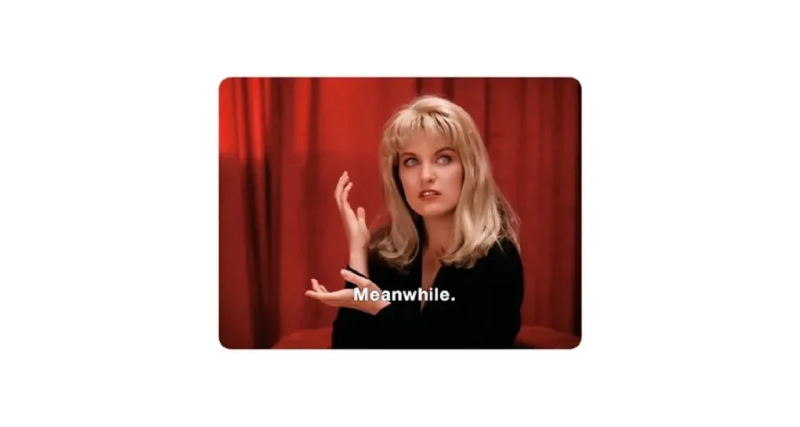David Lynch n’a jamais eu l’image d’un artiste politique. En apparence, la valeur de son œuvre est essentiellement esthétique et plastique, ou encore psychologique, morale, mystique. C’est le Magicien d’Oz en guise de théorie critique. Ne masque-t-il pas les rapports de pouvoir sous un discours manichéen, sous une fausse conscience où le bien et le mal semblent s’affronter dans une lutte aussi abstraite qu’interminable (nihilisme négatif), et où le mal, regardé en face comme un abîme sans fond, exerce sur nous sa séduction morbide vertigineuse (nihilisme réactif) ? Lynch ne nous invite-t-il pas, face à la violence du monde, à pratiquer la méditation transcendantale comme seul refuge, à laisser être et à accepter le réel tel qu’il est (nihilisme passif) ?
Il aura fallu attendre 2017, avec la Partie 8 de la saison 3 de Twin Peaks, pour voir surgir une référence explicitement politique dans le cinéma de Lynch : une origine terrestre y est assignée à Bob, l’esprit malfaisant qui, sorti de Black Lodge, a tué Laura Palmer au terme d’une lutte terrible. Le mal a surgi le 16 juillet 1945 à 5:29 du matin, lors du premier essai nucléaire américain à White Sands, dans le désert du Nouveau-Mexique, trois semaines avant les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Cette périodicité est décisive : Twin Peaks ne parle pas du mal comme d’un principe métaphysique général et abstrait, mais d’un mal politique, sublunaire. Le sujet de Lynch a toujours été l’Amérique. Non pas seulement l’Amérique en tant que réalité sociale et politique, mais l’Amérique en tant que projet métaphysique, l’Amérique en tant que force attractive et productive dans le destin moderne du monde.
Cette Partie 8 est le cœur de toute l’intrigue de Twin Peaks, et l’un des sommets du cinéma de Lynch. La référence à la violence nucléaire n’est qu’un indice. Mon idée directrice est que tout le cinéma de…
Auteur: dev