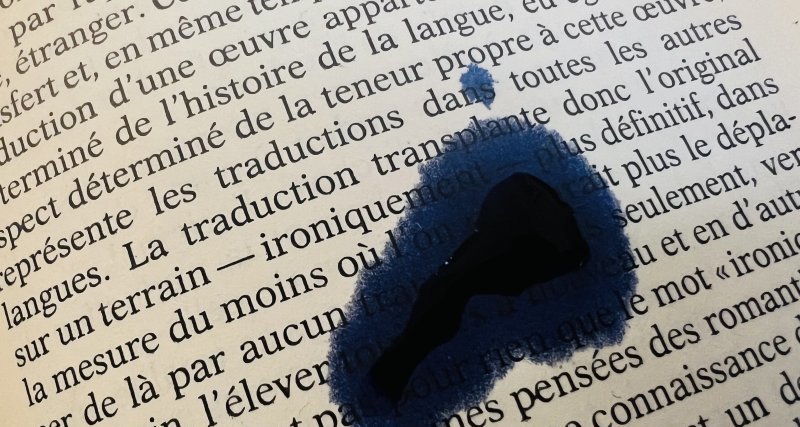Ferenczi dit que chaque langue émet, pour elle-même, son propre idiome onirique. C’est dire qu’il existe des langues vernaculaires du rêve et que celles-ci viennent redoubler celles de nos sols. Un idiome onirique pourtant – et contrairement à un dialecte régional – ne se donne pas comme s’il s’agissait d’un fait primitif sur lequel compter. Il émerge bien plutôt, à la suite d’une archéologie psychique laborieuse, comme le résultat d’un obscur processus. Ce processus est analogue à une traduction.
Étudier la formation d’un idiome onirique, c’est entrer par la poterne dans l’enceinte de la traduction. Une œuvre traduite d’une langue étrangère peut très bien se fondre sans accrocs dans la langue hospitalière ; elle peut aussi donner le sentiment d’y être entrée à coup de bélier – laissant derrière elle certains morts, certains mots. Plus rarement – comme tout ce qui est précieux – il arrive qu’une traduction s’installe à la frontière des langues et que, de cette apatride insistance, naisse une nouvelle communauté. Ce n’est aucun des cas de la traduction onirique.
La langue traduite dans le rêve, c’est celle de la transparence du désir ; la langue d’arrivée, celle de la censure. L’œuvre traduite, ici le rêve, se joue dans la langue châtiée de ce que la conscience peut admettre en elle, relativement aux normes de la mondanité du moi. L’original lui, ici le désir inconscient, s’était énoncé dans la langue infantile de l’exigence sans filtre. En cela, l’original ne pouvait être traduit dans la conscience que sur un mode détourné : à la manière dont les traducteurs français de Dostoïevski ont pu avoir tendance à relever le registre d’un style que Markowicz a su réaligner au ton russe. Ni hospitalité, ni bélier, ni bivouac transfrontalier : le phénomène de traduction qui fait passer la langue du désir dans celle de la conscience est une guerre civile…
Auteur: dev