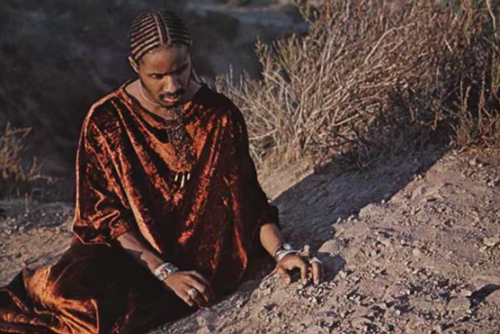Comme tous les jours depuis sa naissance et comme tous les dormeurs, il aura vu avec d’autres yeux que les yeux du corps, que les yeux de chair. Au réveil, il lui faut se rendre à l’évidence : « Ce rêve m’oblige. » Ce matin d’été 1979, un sentiment d’urgence pousse Stevie Wonder à décrocher son téléphone :
« J’écrivais une chanson en son honneur. Vous et moi faisions une marche, pétitions à la main, pour faire de l’anniversaire du docteur King un jour de fête nationale. »
Coretta Scott King n’est pas insensible à ce récit, mais elle peine à partager l’enthousiasme légendaire de son interlocuteur :
« Je vous souhaite bon courage, mon cher Stevie. Je ne pense pas que cela arrivera un jour. »
C’est la lassitude qui parle. Coretta s’est battue pour la cause, elle a également tout fait pour changer l’image de son mari, encore mal-aimé par l’Amérique blanche en 1968. Cette année-là, qui est celle de la mort du pasteur, un sondage révèle que les avis défavorables sont majoritaires (75 %). On perçoit MLK comme un individu « dangereux » et « clivant » [1]. Ses ennemis politiques, eux, en font un « agitateur communiste », certainement sans y croire réellement, car l’argument est bancal : qui a lu Martin Luther King sait qu’il a consacré un prêche à une idéologie qu’il considère comme contraire à l’exercice de la foi [2]. Son anticapitalisme, qui est toutefois indéniable et s’accentuera avec le temps, s’enracine plutôt dans un désir de justice socioéconomique propre au Black Church Power et à la manière dont l’Église a structuré et organisé la lutte. Si les temps donnent raison à Coretta, l’avenir la contredira.
Le 2 novembre 1983, la bataille juridique démarrée au lendemain de la mort tragique de MLK prend fin. Dans la roseraie de la Maison-Blanche, en ce jardin tranchant avec la froideur muséale et marmoréenne des intérieurs présidentiels,…
Auteur: Nathan Reneaud