Dans l’expérience de l’ennui, rien ne se passe sauf le temps qui passe. Comme le rappelle le philosophe roumain Emil Cioran, l’ennui transforme tout l’« univers […] en après-midi de dimanche ». L’ennui, c’est donc l’épreuve d’un temps pur, évidé et mis à nu.
Bien avant de devenir une préoccupation en entreprise, philosophes, poètes et romanciers se sont depuis longtemps penchés sur l’ennui comme phénomène affectant directement et profondément l’être humain.
Ainsi, l’écrivain Gustave Flaubert met en scène l’ennui à travers le personnage d’Emma Bovary, une femme qui rêve sa vie au lieu de vivre ses rêves. Il insiste notamment sur la vacuité de ses journées et sur cet ennui qui étend sa toile comme une araignée.
« Sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l’ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l’ombre, à tous les coins de son cœur. »
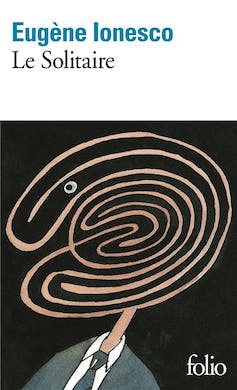
Le Solitaire, Eugène Ionesco (1973).
Avec Madame Bovary, Flaubert ausculte le silence de la campagne provinciale et les états d’âme d’une enfant du siècle. Ici, l’ennui est cette compagne d’infortune qui surgit quand les rêves meurent.
On retrouve la puissance dévastatrice de l’ennui dans Le Solitaire, le premier et unique roman publié par l’écrivain franco-roumain Eugène Ionesco. On y découvre le quotidien d’un homme qui reçoit un héritage inattendu et se retire des turpitudes de la vie salariale : il décide de devenir le spectateur de la vie des autres.
À l’écart du monde, il fait l’expérience d’une solitude vertigineuse et d’un ennui profond. Dès lors, sa vie est rythmée par les épanchements de son âme isolée :
« J’ai le vertige et j’ai peur de l’ennui […] L’ennui paralyse ou ne vous fait faire que des actions destructrices ou vous met dans un état voisin de la mort. »
Dans le roman, l’ennui est également comparé à un animal tapi dans l’ombre et prêt à bondir à la moindre occasion :
« Je sens à l’arrière-fond que l’ennui est là, qu’il me guette, me menace, qu’il peut grandir, m’envelopper, m’étouffer. »
Dans ces conditions, l’ennui apparaît comme une sensation de vide très singulière qui va devenir un leitmotiv voire une obsession pour les philosophes pessimistes, les poètes symbolistes et les romantiques (Lamartine, Cioran, Pessoa…).
« L’art de bâiller sa vie »
Appliqué à l’entreprise, l’ennui offre de nombreuses pistes d’investigation. Dans le cadre d’un article de recherche récent centré sur les réunions de travail, l’ambivalence de l’ennui est apparue comme un des résultats majeurs des entretiens menés auprès des participants.
Loin d’être uniquement un état affectif désagréable et pernicieux, l’ennui peut être le signe de notre humanité. Ainsi, lorsque l’ennui est ressenti pendant de longs moments, il est néfaste et destructeur alors qu’en advenant sur de courtes périodes, l’ennui se fait moment de respiration et trésor de créativité.
[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Au-delà de cette ambivalence, c’est bien le caractère tabou de l’ennui qui s’est manifesté dans les échanges avec les participants aux réunions. Il est en effet malséant de parler d’ennui publiquement en vertu des conventions sociales. Notre inconscient collectif est très largement imprégné par cette maxime commune : « l’oisiveté est la mère de tous les vices ». Comme le rappelait Palmyre* :
« [L’ennui], on n’en parle pas forcément, c’est un peu tabou. »
Parler d’ennui dans un contexte organisationnel va à l’encontre des normes et des conventions qui régissent les relations interpersonnelles au travail. Les salariés concernés par l’ennui préfèrent finalement réfréner et intérioriser leurs émotions plutôt que de les exprimer car ce temps de rêverie semble ne pas avoir sa place dans des environnements compétitifs.
Read more:
Le « blasé » en entreprise, une victime de la routine ?
L’ennui reste très largement affublé d’une connotation négative, il est souvent associé à l’oisiveté, à la paresse ; bref, c’est « l’art de bâiller…
La suite est à lire sur: theconversation.com
Auteur: Thomas Simon, Assistant Professor, Montpellier Business School

