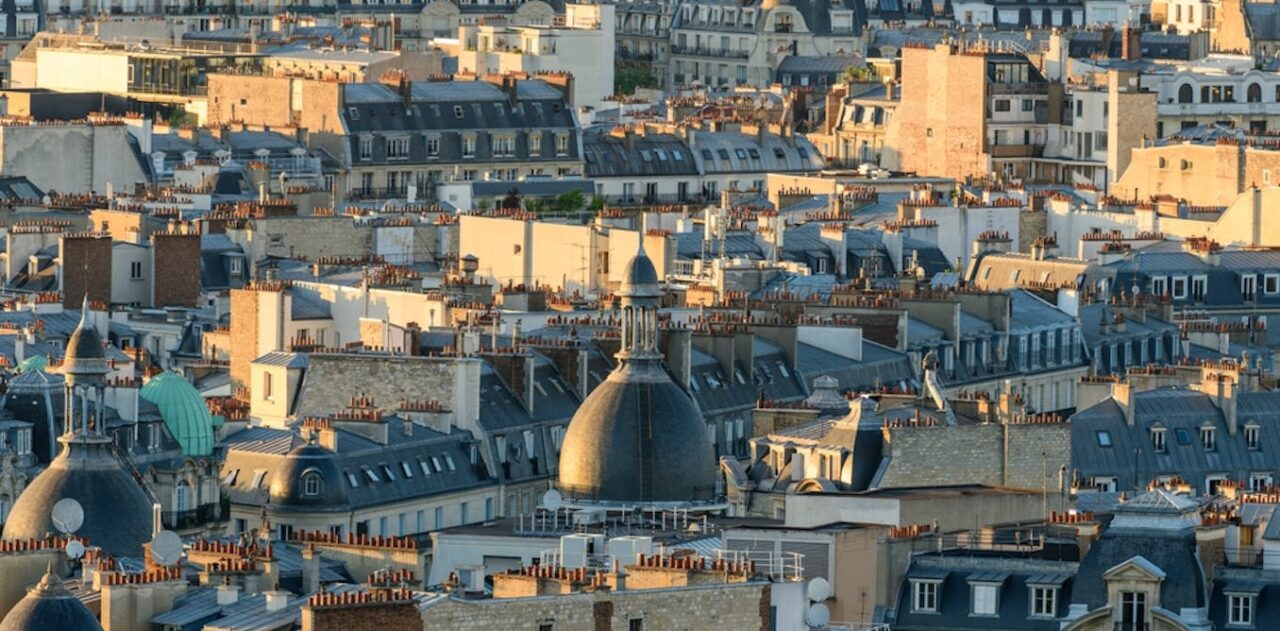Depuis la fin des années 1970, la politique de la ville a multiplié les dispositifs de soutien aux quartiers qualifiés au départ de « sensibles », puis plus récemment de « prioritaires » : rénovation des logements insalubres, construction de logements sociaux, lutte contre la délinquance, exonérations fiscales visant à soutenir l’installation des entreprises et à créer des emplois pour les résidents, soutien à l’éducation et à la réussite scolaire.
Pourtant, les violences urbaines qui jalonnent l’histoire des banlieues françaises depuis presque cinquante ans illustrent les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour enrayer la paupérisation croissante de certains quartiers, et les phénomènes de ségrégation urbaine.
Le taux de pauvreté est ainsi encore en moyenne trois fois plus élevé dans les quartiers « prioritaires », comparé aux autres quartiers de la même unité urbaine (43 % contre 13,5 %), le taux de chômage plus de deux fois supérieur (18,6 % vs 8,5 %), la part des résidents étrangers 2,4 fois plus forte (21,8 % vs 9,2 %), et la part des locataires du parc HLM 4,6 fois plus importante (74 % vs 16 %).
De nombreux travaux académiques ont analysé les raisons pour lesquelles « les politiques zonées », malgré d’importants moyens financiers déployés, n’ont pas produit les résultats escomptés. Les exonérations fiscales ont par exemple permis d’attirer des entreprises et de créer des emplois, mais ces gains se sont souvent opérés au détriment des quartiers avoisinants, ils ont bénéficié à des populations qui n’étaient pas celles ciblées au départ, et ils se sont rapidement taris au cours du temps.
Par ailleurs, la labellisation même des quartiers (« sensibles » ou « prioritaires ») est de nature à engendrer des effets de stigmatisation qui peuvent aussi s’avérer contre-productifs. Dans une étude récente, qui mobilise des données du…
La suite est à lire sur: theconversation.com
Auteur: Manon Garrouste, Maître de conférences en économie, Université de Lille