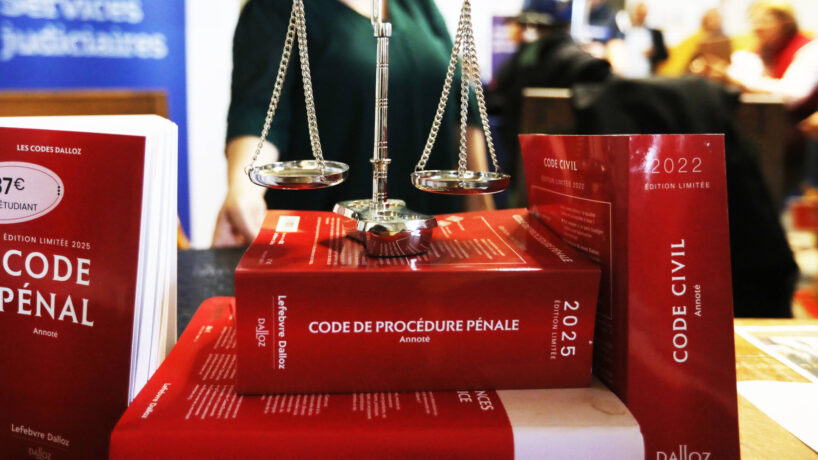Les sénateurs ont adopté à l’unanimité, jeudi 3 avril, la proposition de loi pour « renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ». Un peu plus tard dans la journée, l’Agence France Presse relaye l’information : « Le Sénat vote pour l’introduction du contrôle coercitif dans la loi ». Et pourtant, à peu près au même moment, le quotidien L’Humanité publie un article titré exactement de façon inverse : « Le Sénat, efface la notion de contrôle coercitif de la proposition de loi sur les violences sexistes et sexuelles ». Pour comprendre cette situation pour le moins antinomique, et cette différence d’appréciation, il convient de se replonger dans les débats qui ont agité la Chambre haute jeudi après-midi.
Cette proposition de loi, proposée dans la foulée de l’affaire des viols de Mazan par l’ex-députée Aurore Bergé, porte une réforme des délais de prescription mais entend également mieux armer notre corpus législatif contre certains agissements. Une large part de la discussion publique s’est ainsi cristallisée autour de la création d’une infraction de contrôle coercitif. Les sénateurs ont très largement modifié ce segment, afin d’éviter de nombreux écueils juridiques, mais tout en essayant d’en conserver l’esprit. Explications.
Une notion ancienne
Fin janvier, les députés ont tenu à faire rentrer dans la proposition de loi cette notion développée dans les années 1970, mais…
Auteur: Romain David