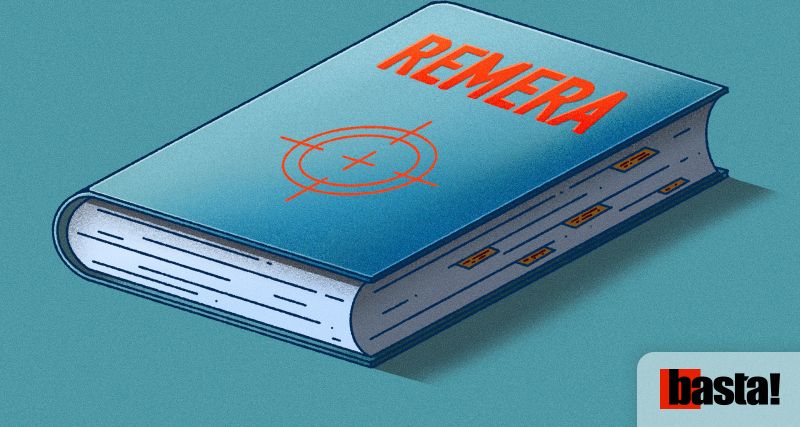Des classeurs, des étages de classeurs, du plancher au plafond. Ils contiennent des données sensibles : 90 000 dossiers documentés de malformations congénitales, dépistées avant ou après la naissance. Des données souvent synonymes d’épreuves pour les familles concernées, mais qui peuvent se révéler précieuses en matière de santé environnementale pour rechercher la cause de ces malformations et en prévenir l’apparition quand elles sont liées à des expositions à des polluants.
Ces murs de classeurs sont situés dans un tout petit local au cœur de la ville de Lyon, les bureaux du Remera, pour Registre des malformations en Rhône-Alpes. Cette association et son équipe mènent ce travail de collecte depuis plus de cinquante ans. « Nous surveillons toutes les issues de grossesses des mères qui résident dans le Rhône, l’Ain, la Loire et l’Isère, pour lesquelles des anomalies ont été détectées chez l’embryon, le fœtus ou l’enfant », précise Emmanuelle Amar, directrice du Remera depuis 2007.
Collecter des données, les organiser, mesurer si les malformations augmentent et les signaler, mettre ces informations à la disposition des chercheurs, telle est la mission d’utilité publique menée par le Remera. Ce matin-là, les deux seules collaboratrices d’Emmanuelle Amar sont sur le terrain, dans les services de maternité, pour accéder aux dossiers des patientes et récupérer les données. « Ça peut étonner que le registre soit encore fait de manière si ’’archaïque’’, mais il faut avoir en tête que les données hospitalières, en cas de malformations, ne sont transmises nulle part ! Cela reste dans les tiroirs des hôpitaux si nous ne faisons pas ce travail », explique Emmanuelle Amar.
C’est précisément grâce à ce registre qu’Emmanuelle Amar identifie un cluster de huit cas d’enfants nés sans bras,…
Auteur: Sophie Chapelle