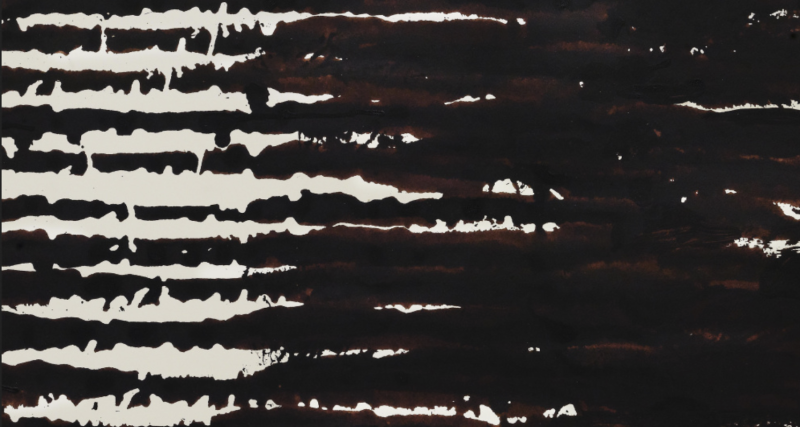À la suite de notre entretien avec Norman Ajari, qui réengageait la tradition radicale noire dans le sens de la souveraineté autonome noire, Florian Gulli nous avait proposé une réponse historico-politique. La voici. Dans les discussions antiracistes, la référence au moment du Black Power (après 1965 aux États-Unis) est centrale. Notamment pour un type de stratégie : le refus des coalitions et la construction d’organisations non-mixtes. Nous voudrions montrer que ces options stratégiques, qui n’étaient pas neuves si l’on pense à la Nation of Islam et à l’Universal Negro Improvement Association, sont loin d’avoir fait consensus parmi les militants.
Dans l’ouvrage Black Power qu’il co-écrit avec Hamilton, le leader du Student Nonviolent Coordinating Committee, Stokely Carmichael dénonce « les mythes de la coalition » entre militants blancs et noirs dans la lutte contre le racisme aux États-Unis. Les groupes avec qui pourraient s’allier les Afro-américains devaient abjurer les « valeurs et les institutions fondamentales de la société ». Mais, était-il ensuite répété, le Blanc, « quel que soit son degré de libéralisme », en était alors incapable. La prémisse du raisonnement était la suivante : « face aux revendications du peuple noir, les multiples factions blanches s’unissent et présentent un front commun ». Dont l’objectif aurait été de maintenir les Noirs à leur place. Les Blancs faisant bloc, l’urgence politique sera de faire en sorte que les Noirs serrent les rangs et se dotent de leurs propres organisations.
Conformément à cette analyse, le SNCC décide en 1966, à une courte majorité (19 voix pour, 18 contre et 24 abstentions), d’exclure ses militants blancs. Cette proposition, qui est parfois attribuée à Carmichael, émanait en réalité de militants d’Atlanta qui avaient publié un manifeste en ce sens. Néanmoins, souligne l’historien Clayborne Carson, dans…
La suite est à lire sur: lundi.am
Auteur: dev